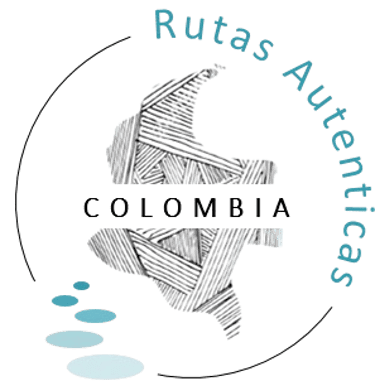Violence et narcotrafic
L'origine
La violence en Colombie trouve ses racines dans son modèle de développement économique qui a créé de profondes inégalités sociales, une concentration extrême des terres et des richesses, et par une répression brutale des mouvements populaires par l’état souvent en collusion avec les élites économiques, les multinationales et les forces armées.
Deux évènements majeurs marqueront la précipitation de la société colombienne vers la violence.
En 1928 : Répression sanglante d’une grève d’ouvriers dans une compagnie de fruits faisant des centaines de morts, Massacre des Bananeras.
En 1948 l’assassinat du leader populaire du Parti libéral Jorge Eliécer Gaitán déclenche une insurrection urbaine, El Bogotazo, qui marque le début de la guerre civile entre libéraux et conservateurs La Violencia (1948–1958),.
Naissance des guérillas
Après des événements comme La Violencia (1948–1958) et l’assassinat de Jorge Eliécer Gaitán, de nombreux militants ont perdu confiance dans les voies démocratiques et se sont tournés vers la lutte armée pour revendiquer des réformes sociales, notamment la réforme agraire.
FARC (1964) : Issues de milices paysannes, influencées par le marxisme-léninisme. Objectif : réforme agraire.
ELN (1964) : Inspiré par la Révolution cubaine et la théologie de la libération. Fondé par des intellectuels et étudiants.
M-19 (années 1970) : Guérilla urbaine née d’une fraude électorale présumée. Se démarque par des actions spectaculaires. Se démobilise en 1990 pour devenir un parti politique.
Financement des guérillas
À leurs débuts, les groupes comme les FARC et l’ELN se finançaient principalement grâce à des contributions volontaires de leurs sympathisants, souvent des paysans, et à une « taxe révolutionnaire » imposée dans les zones sous leur contrôle. Cette taxe était présentée comme une forme de participation à la lutte pour la justice sociale et la réforme agraire
Dans les années 1980, les guérillas ont eu recours à des enlèvements massifs et à l’extorsion systématique. Elles ciblaient aussi bien les agriculteurs, les entreprises locales, que les multinationales. Cette pratique est devenue une véritable industrie lucrative, mais elle a aussi terni leur image auprès de la population et de la communauté internationale.
A partir des années 1980–1990, le trafic de cocaïne est devenu la principale source de financement des guérillas, en particulier pour les FARC. Certaines factions ont même intégré pleinement les circuits de production et de distribution de drogue, tandis que l’ELN se contentait souvent de taxer les cultures de coca.
Cette implication dans le narcotrafic a modifié la nature du conflit, le faisant passer d’une lutte idéologique à une guerre mêlant intérêts politiques et logiques criminelles. Elle a aussi permis au gouvernement et aux États-Unis de requalifier les guérillas en « narco-terroristes », justifiant ainsi une intensification de la répression militaire.
Luttes contre les guérillas
Face à l’expansion des guérillas, l’État colombien a opté pour une stratégie de guerre totale, intensifiant la présence militaire dans les zones rurales. Cette militarisation s’est traduite par une augmentation des opérations armées, souvent accompagnées de violations des droits humains, notamment des massacres et exécutions extrajudiciaires.
Dans les années 1990, des groupes paramilitaires sont créés par des élites locales, des narcotrafiquants et des entreprises, dans le but de combattre les guérillas et protéger les intérêts économiques. Ces groupes ont mené des campagnes de terreur contre les civils, notamment contre les syndicalistes, leaders sociaux et communautés rurales, souvent avec la complicité ou la passivité de l’armée.
Ce programme Colombia (2000) a consisté en l’aide militaire massive des États-Unis, lancé en 2000, visait à affaiblir les guérillas et à lutter contre le narcotrafic. Bien qu’il ait permis de réduire la capacité militaire des FARC, il a aussi entraîné des règlements de comptes, des déplacements massifs de populations et le renforcement des groupes paramilitaires, qui ont occupé les territoires abandonnés par les guérillas.
Tentatives de paix
Un premier accord est signé en 1984 entre l’état et les FARC cependant plus de 5 000 de leurs membres sont assassinés, sapant la confiance dans le processus démocratique. De 1998–2002, de nouvelles négociations s’engagent mais échouent. En 2016 un accord de paix historique est signé entre le gouvernement les FARC prévoyant la démobilisation et la transformation des FARC en parti politique, la mise en place de réformes agraires, la création de la Justice Spéciale pour la Paix (JEP), des réparations pour les victimes.
Néanmoins l’accord de 2016 n’a pas mis fin aux actions violentes. L’assassinat d’ex-FARC et de nombreux leaders sociaux persistent, les groupes dissidents, ELN, paramilitaires et cartels continuent de se disputer les territoires et les ressources illégales. La corruption, l’impunité et l’influence du narcotrafic freinent la consolidation de la paix.